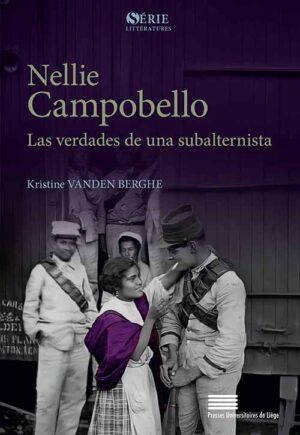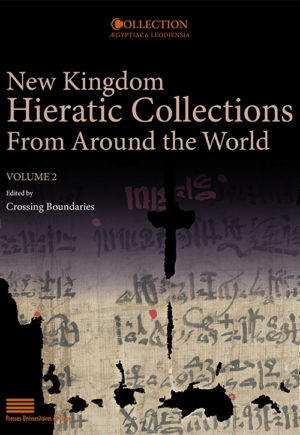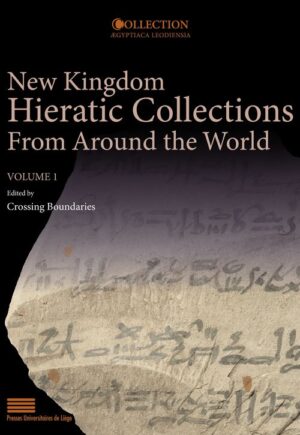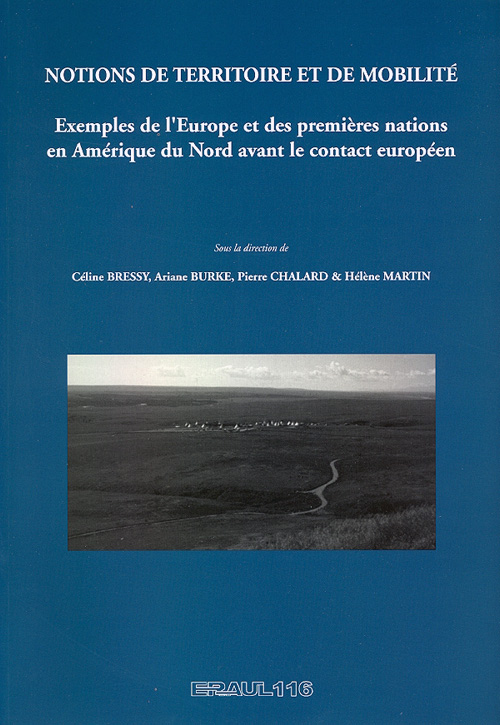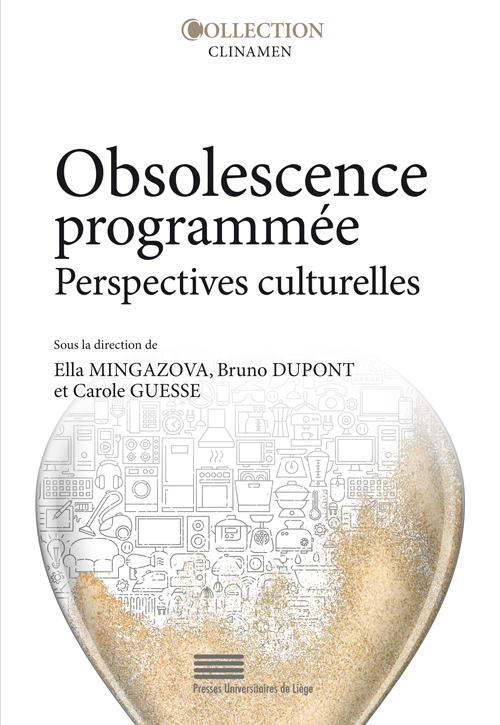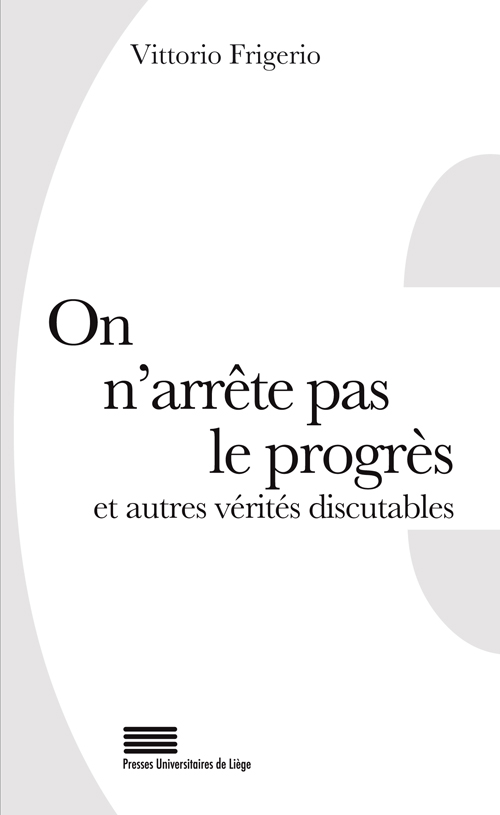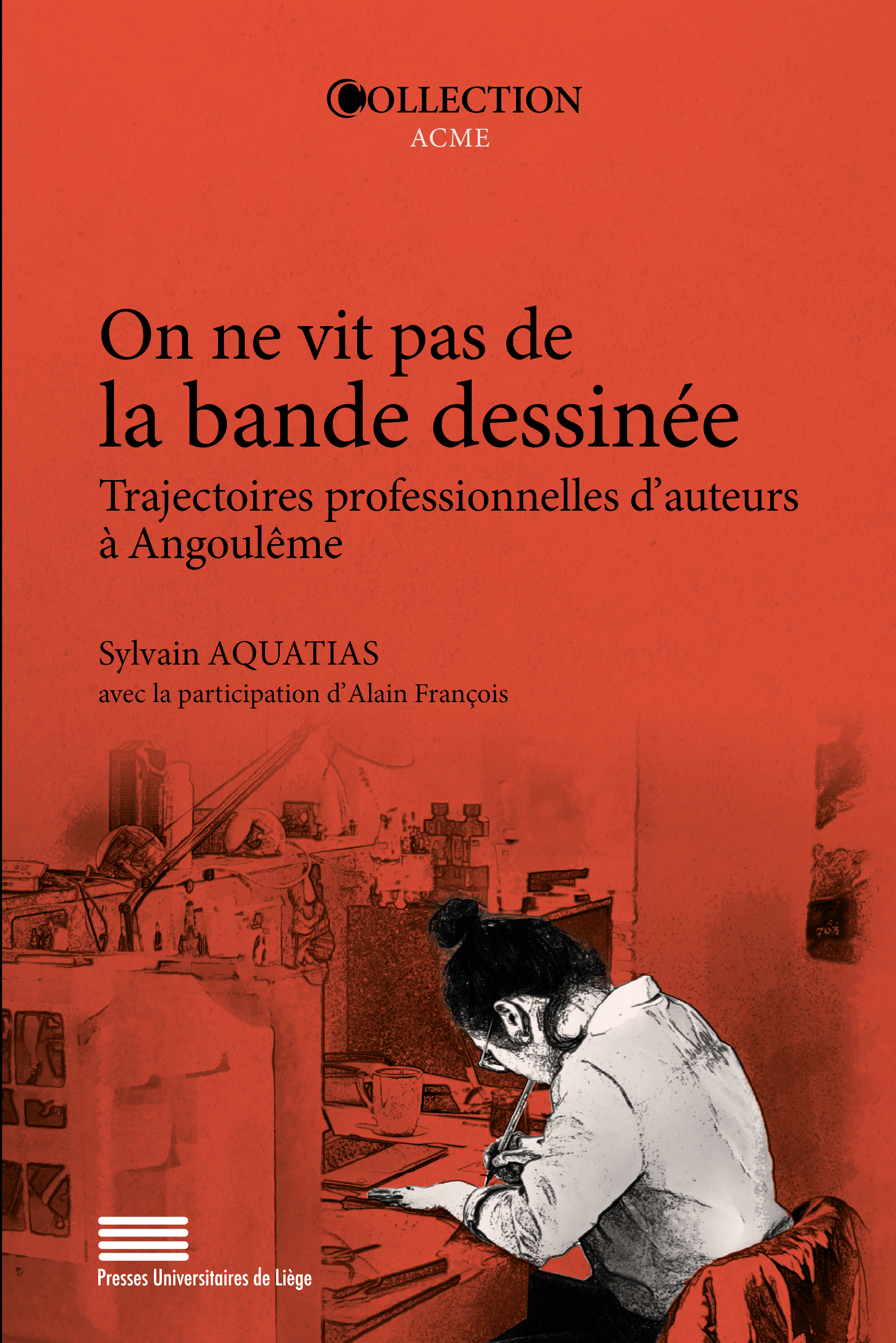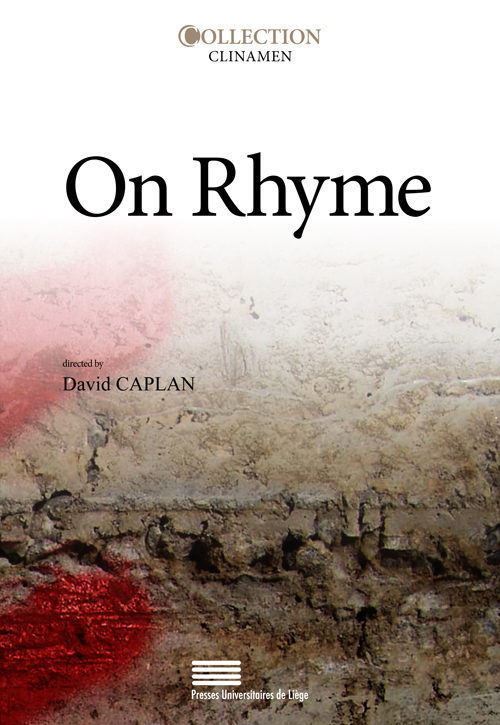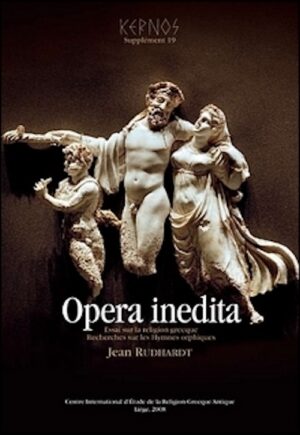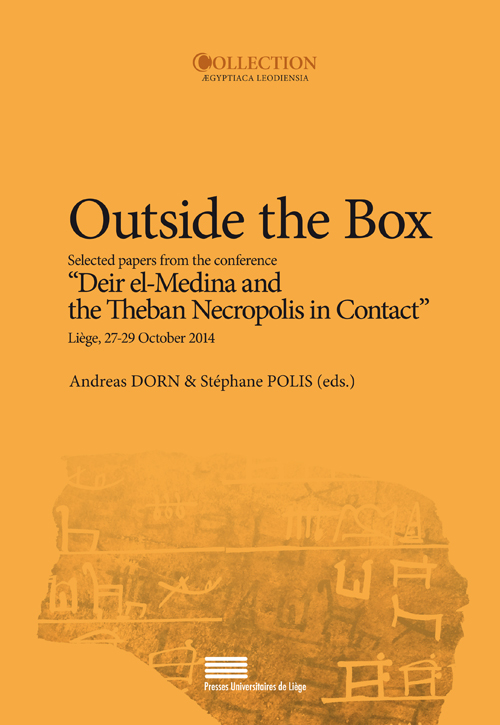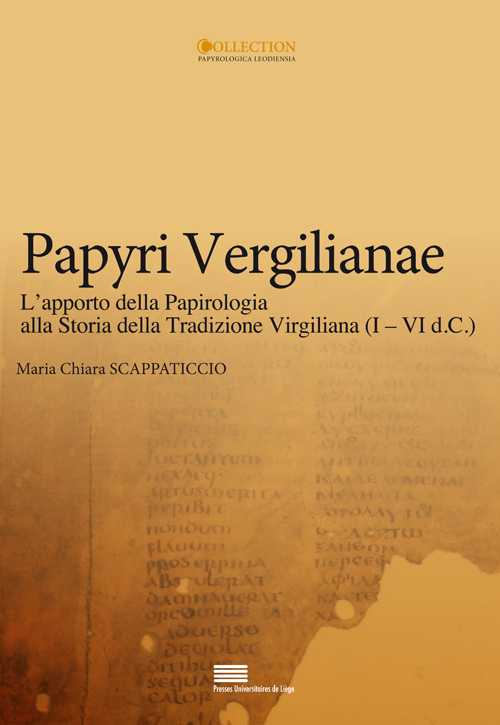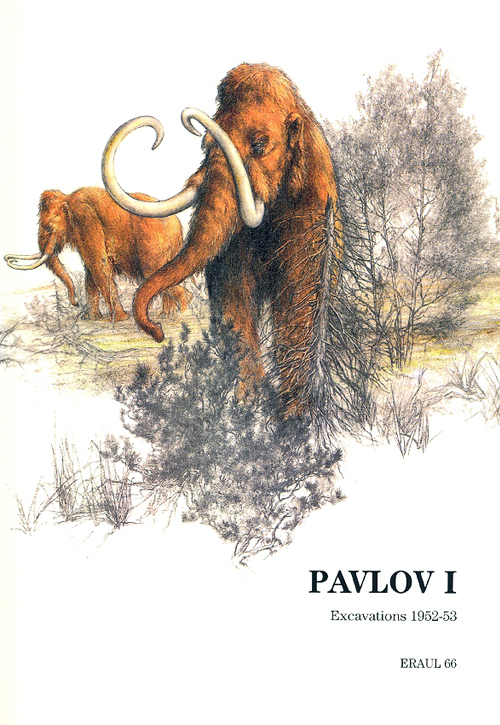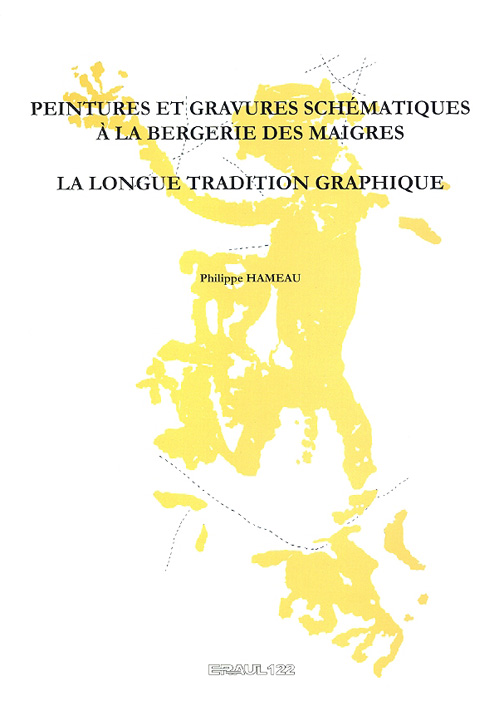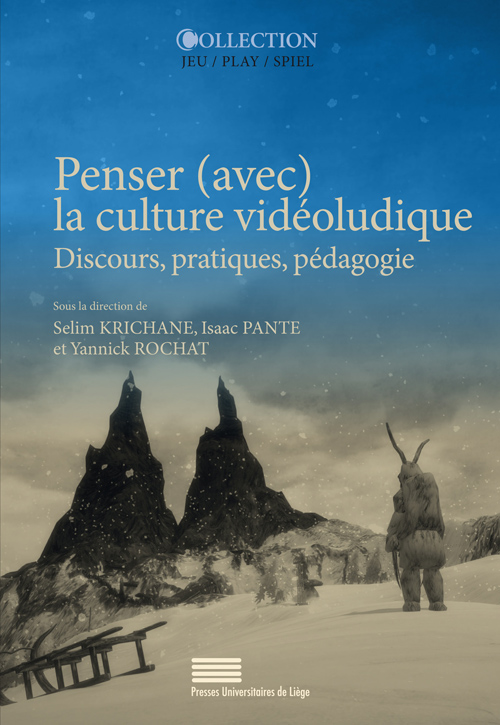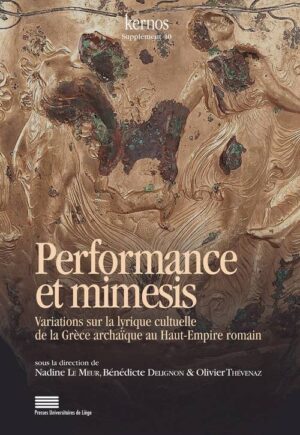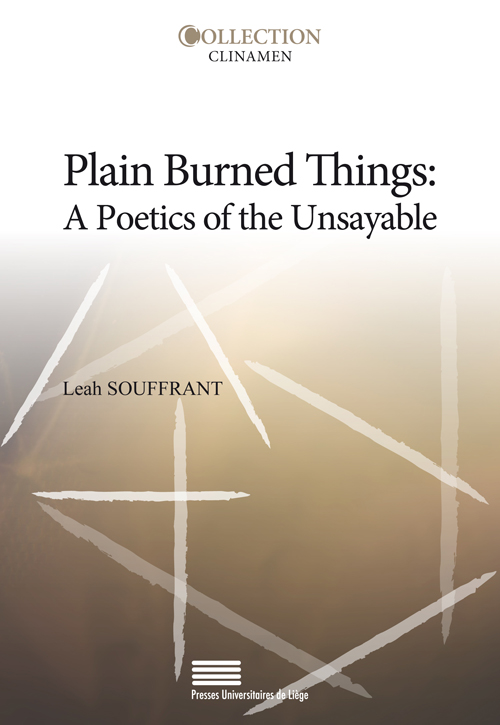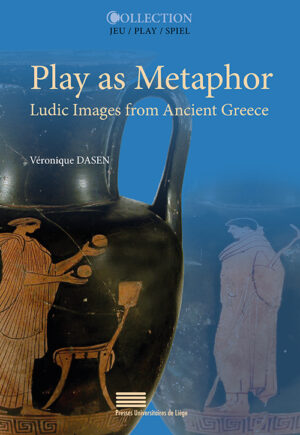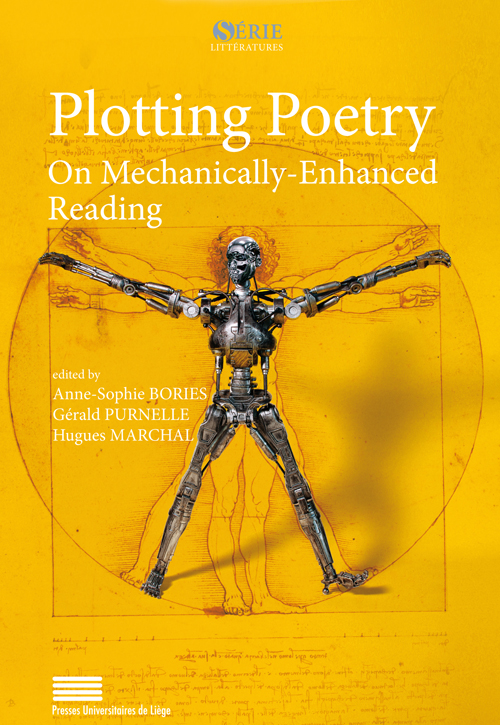Sobre Cartucho y Las manos de mamá, los dos libros hermanos que escribiera sobre la Revolución mexicana, Nellie Campobello afirmó que en ellos no hacía otra cosa que decir la verdad. Sin embargo, en ambos textos mezcla la realidad y la ficción de tal manera que genera dudas sobre si es más apropiado leerlos en clave literaria-ficticia o histórica-autobiográfica. En ellos la verdad no resiste a la comprobación empírica, sino que debe entenderse como una promesa de representar los hechos a partir de una perspectiva ideológica “verdadera”. Esta perspectiva es consecuentemente subalternista y la autora pinta al pueblo subalterno de tal forma que suscite simpatía hacia su causa.
Lo logra en primer lugar gracias a sus elecciones formales, entre las cuales destacan la elipsis, el desorden narrativo y la parataxis. Demostramos que estos recursos estilísticos, acordes con el referente del discurso, allegan su obra al estilo primitivo y a la escritura errante, y emparentan su lenguaje con aquel del Antiguo Testamento y los corridos, pero también con la obra de Juan Rulfo de la cual es un antecedente importante.
A generar comprensión hacia las personas subalternas contribuyen igualmente los retratos que les pinta en términos de afectos. La gente del pueblo, los jóvenes que entran en la Revolución y las personas que sufren hambre representan una comunidad emocional que se deja afectar y que “piensa con el corazón”. Contrasta con otra que, fría y racional, es integrada por quienes ejercen mal su autoridad.
Entre los personajes de Campobello destaca una galería de mujeres — especialmente la narradora Nellie, su madre Rafaela y Nacha Ceniceros — que se retratan en función de su fortaleza y resiliencia, pero también de su espíritu de venganza y de su vitalismo. Este gusto por la vida y sus placeres apunta a la filosofía del vitalismo de Nietzsche, un filósofo bien conocido y muy leído en el México de su época.
Los recursos estilísticos y los retratos de sus personajes desde el punto de vista de los afectos son los principales objetos del presente estudio que procura demostrar que en la obra de Campobello vienen estrechamente vinculados estilo e ideología, acciones y emociones, principios políticos y códigos éticos.
Kristine VANDEN BERGHE es profesora titular de Lengua española y letras hispanas en la Université de Liège. Su investigación se enfoca en la literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI, con un énfasis en la narrativa mexicana y colombiana. Ha publicado artículos en numerosas revistas académicas y en esta serie “Littératures” ha editado con Catalina Quesada el volumen titulado El libro y la vida (2019) sobre la obra de Héctor Abad Faciolince; y, con Nicolas Licata y Yanna Hadatty Mora, Tradición y transgresión (2023), acerca de la escritora Guadalupe Nettel. Después de Homo ludens en la revolución (Iberoamericana/Vervuert/Bonilla 2013), este es el segundo libro que dedica a la obra de Nellie Campobello.