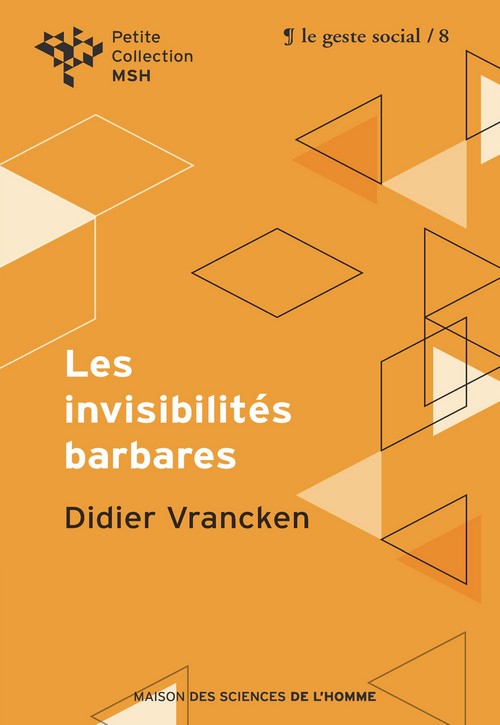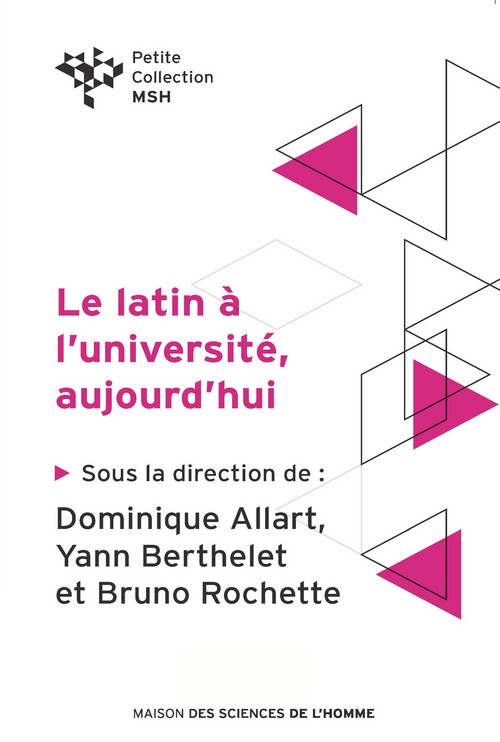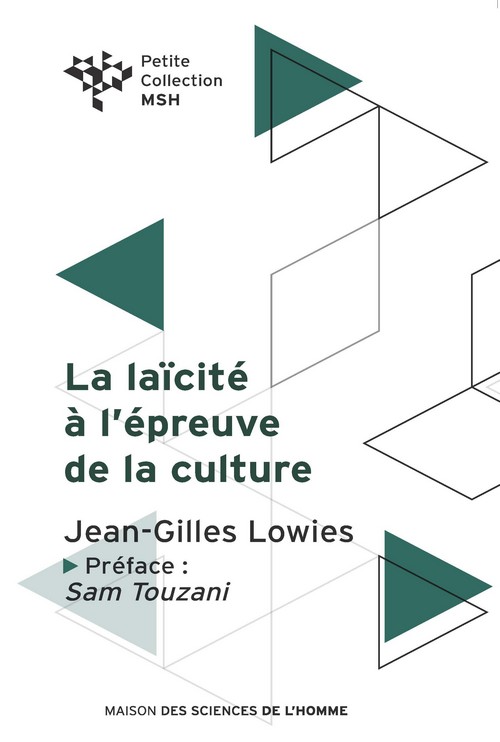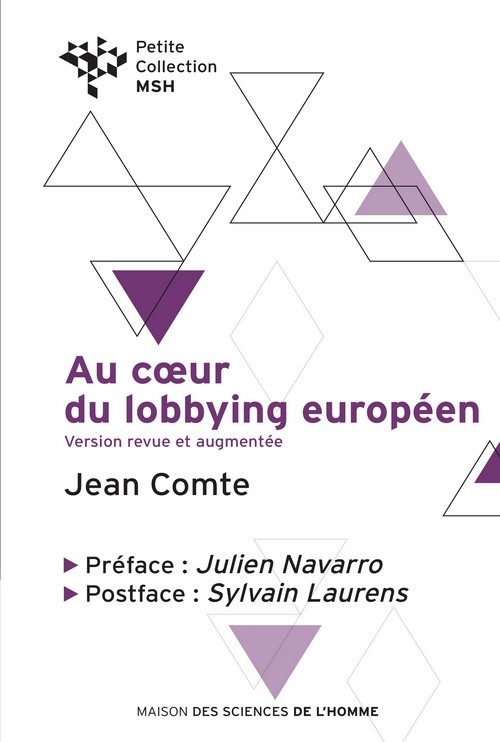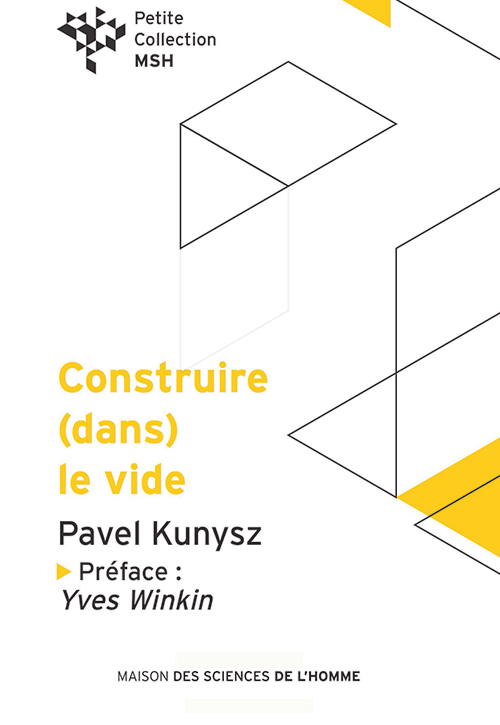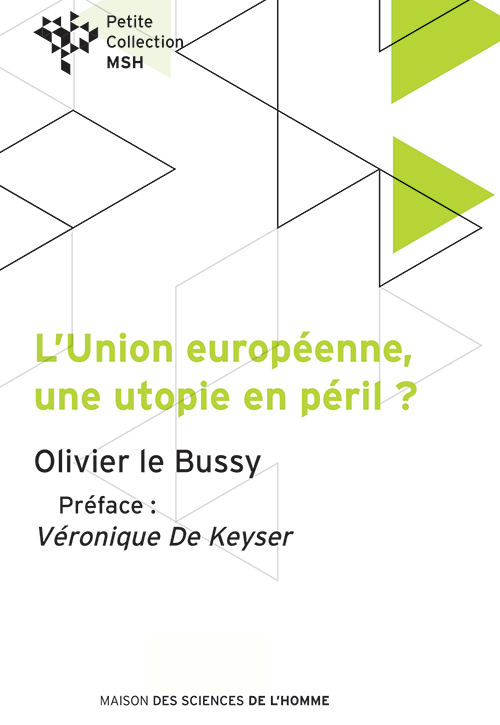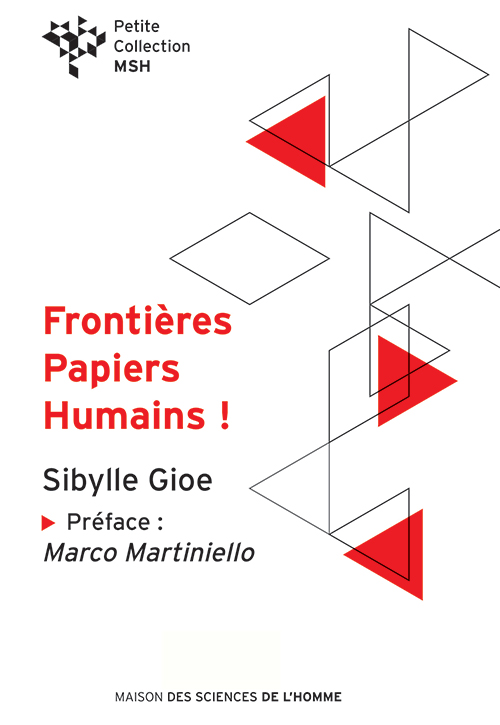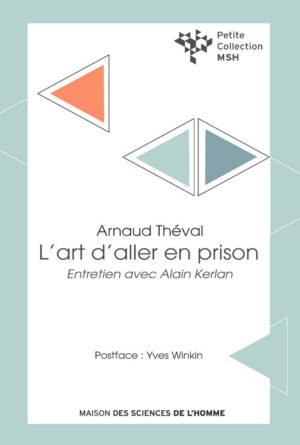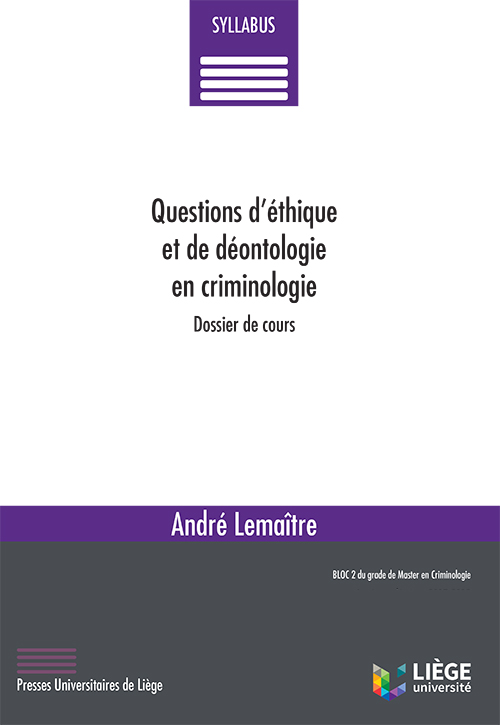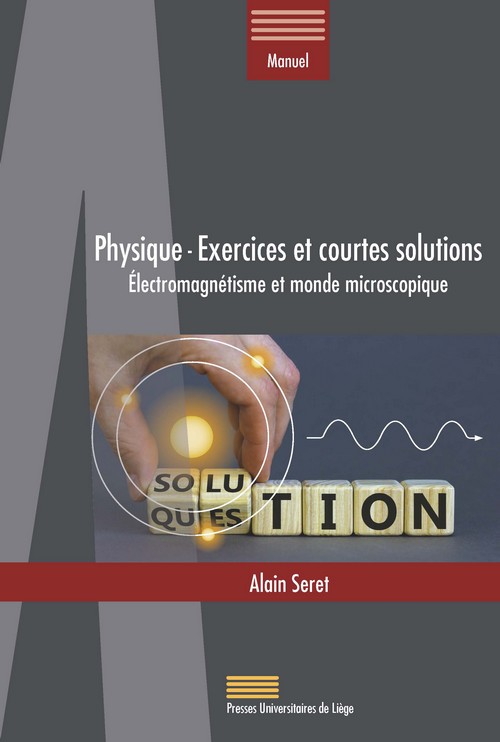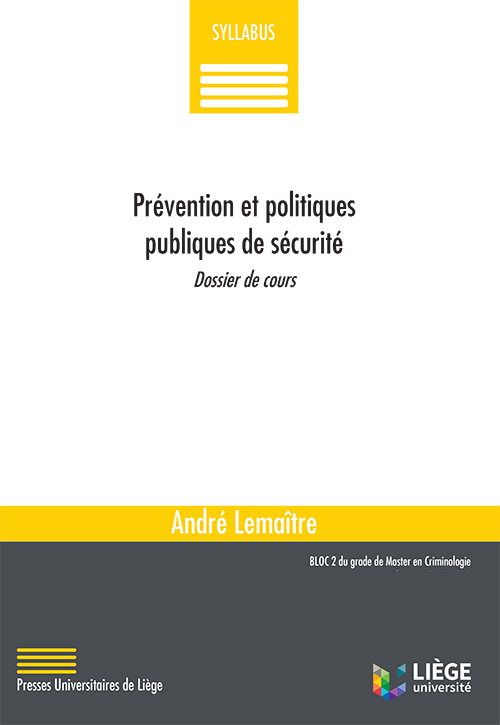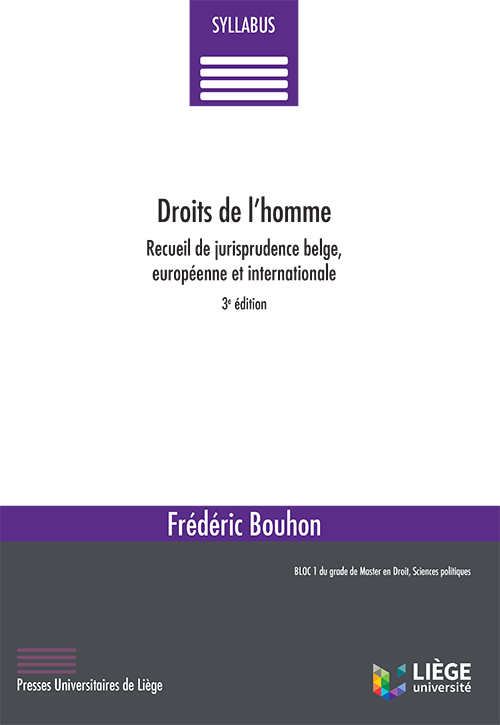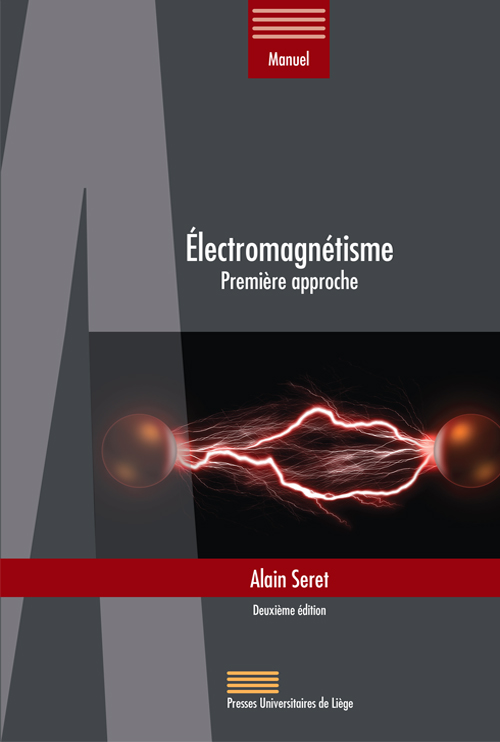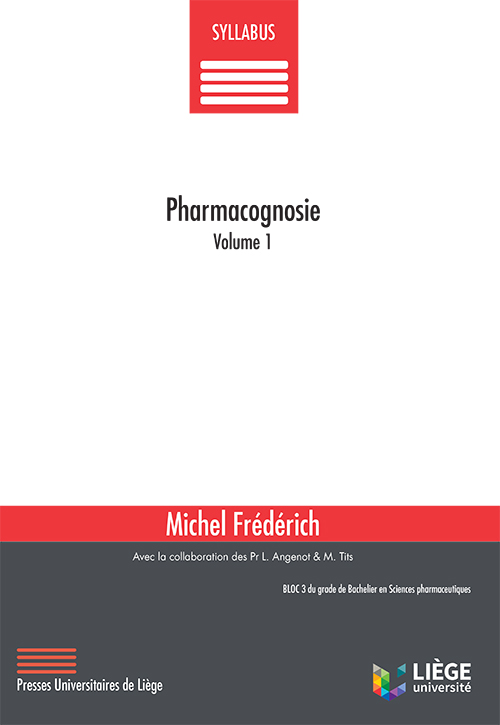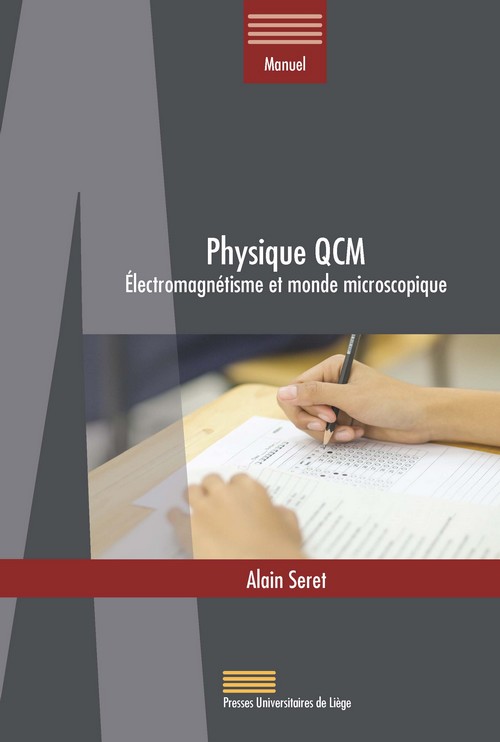Repenser l'intervention sociale par DIDIER VRANCKEN
En quelques décennies à peine, nous avons assisté à une curieuse inversion de sens : les personnes précarisées n’apparaissent plus seulement comme les plus vulnérables parmi les plus vulnérables, frappées par le sort et la malchance. Elles sont désormais perçues comme une véritable charge pour la société. Un peu partout en Europe, des voix s’élèvent pour ne plus «payer» pour ces personnes tant elles leurs apparaissent incapables de produire les efforts nécessaires pour s’intégrer au marché de l’emploi, aux valeurs et à la culture des autochtones. Montée des inquiétudes, repli identitaire, peur de l’autre, émergence de véritables démagogues autoritaires, montée des populismes. Comment en sommes-nous arrivés là ? Que s’est-il produit pour que nous assistions aujourd’hui au rejet de ces publics, ces nouveaux «barbares», allant jusqu’à les invisibiliser, alors qu’ils sont parmi nous, au coeur même de la cité ?
Président d’honneur de l’Association internationale des sociologues de langue française, Didier VRANCKEN est Professeur à l’Université de Liège où il dirige la Maison des Sciences de l’Homme.
Ouvrage co-édité avec les Éditions ies